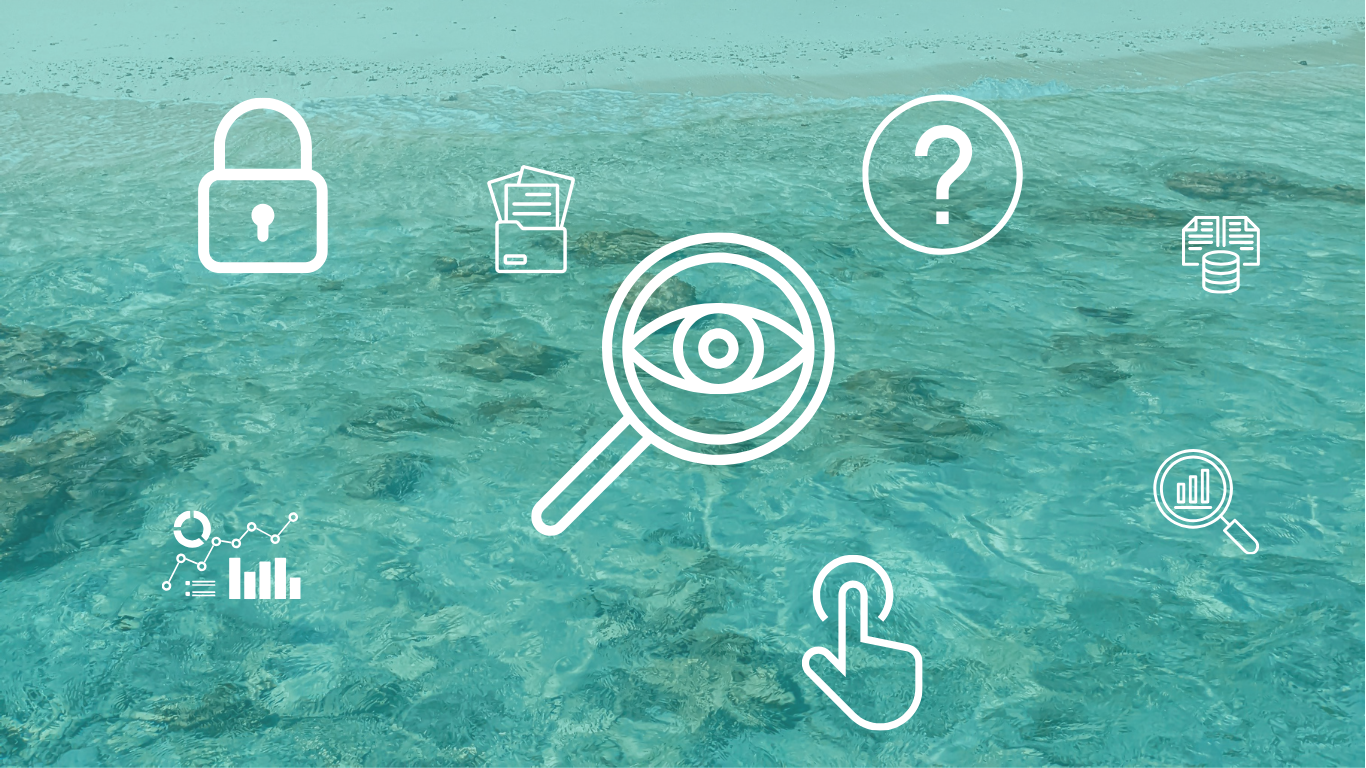
COMPRENDRE BRIDGES OBSERVATION
Un observatoire idéal au cœur de BRIDGES
BRIDGES OBSERVATION vise à définir et mettre en œuvre un observatoire idéal interdisciplinaire (océanographie physique, chimie, écologie, halieutique et sciences humaines et sociales) à différentes échelles spatiales et temporelles. Ainsi, il devra permettre d’acquérir et de partager des informations sur les socio-écosystèmes du sud-ouest de l’océan Indien.
Les 27 et 28 février, 31 chercheurs du programme se sont réunis lors d’un premier atelier de travail. Ils se sont penchés sur la définition de l’observatoire.
Qu’est-ce qu’un observatoire idéal ?
C’est la question complexe et prioritaire à laquelle le projet doit répondre. De cette définition découleront la stratégie d’observation et la mise en place d’infrastructures et de protocoles de recherche.
Trois axes majeurs structurent cette réflexion :
- Quelles sont les données d’observation* nécessaires pour répondre aux questions de recherche ?
Cette question amène à penser un socle commun de données, et des données complémentaires qui répondent à des objectifs explicites.
*Données d’observation: Les données d’observation sont des informations d’origine variées recueillies via des instruments, des capteurs ou des personnes pour documenter et caractériser un processus.
- Quels sont les défis liés à l’acquisition de ces informations ?
Cette question permet d’anticiper les difficultés, les contraintes, les solutions potentielles de l’acquisition des données souhaitées, dans le contexte de chacun des sites atelier. Une stratégie d’observation sera définie sur la base de tous ces éléments.
- Comment rendre les données accessibles à toutes les parties prenantes, aux échelles locale et régionale ?
Tout en étant adapté et servir à chacun des sites, l’observatoire doit proposer une logique globale et coordonnée à plus large échelle. Pour cela, il devra notamment allier frugalité et efficacité, tout en rendant les données disponibles pour tous les acteurs de la région.
Un observatoire pour répondre à des préoccupations locales ?
L’observatoire BRIDGES se situe à l’intersection des besoins de la recherche et des attentes des acteurs de terrain. Comment concilier ces différentes perspectives ? Cette question a nourri les échanges durant l’atelier de février.
Pour enrichir la réflexion, Nicolas Le Dantec et Quentin Ruaud ont présenté l’exemple d’OSIRISC. Mis en place en Bretagne depuis 2016, cet observatoire interdisciplinaire s’intéresse aux risques côtiers et la vulnérabilité des territoires littoraux de la région. Il sert aussi à la construction d’un outil d’aide à la décision à la disposition des gestionnaires.
De cet exemple, plusieurs enseignements clés émergent. Pour assurer la réussite d’un observatoire, il est nécessaire de :
- Encourager les observations collaboratives et harmoniser les pratiques entre acteurs,
- Garantir la pérennité de l’observatoire en intégrant à la fois les besoins des parties prenantes et ceux de la recherche.
Vers une observation plus juste
L’observatoire idéal garantit également une observation plus équitable et responsable, conforme aux principes FAIR : Facile à mettre en œuvre, Accessible, Intégrative et Respectueuse. Le projet cherchera donc à développer :
- Une méthode adaptée aux phénomènes étudiés,
- Une distribution équilibrée des mesures dans l’espace et le temps pour éviter le gaspillage de données,
- Une prise en compte des contraintes locales et des besoins des parties prenantes,
- Une production de données fiables, économiques et écoresponsables,
- Une accessibilité renforcée pour un large public.

Plus d'actualités Actualités


