
BIOMA: Quand le droit interroge la protection de la biodiversité marine
Depuis octobre 2024, Margot Perdereau mène une thèse en droit de l’environnement au sein de BRIDGES CO-CONSTRUCTION, avec pour sujet : La biodiversité marine est-elle bien protégée par le droit ?
Face à l’augmentation des pressions anthropiques sur le milieu marin, cette thèse vise à comprendre où, quand et comment le droit participe à la protection de la biodiversité marine, dans une zone géographique englobant le bassin méditerranéen, l’Afrique et l’Océan Indien.
Pour examiner le contenu des textes juridiques, leur mise en œuvre et ses conséquences, la thèse BIOMA s’appuie sur des méthodes quantitatives et interdisciplinaires développées dans le projet Nawras. L’analyse juridique, la gestion de données et l’écologie marine seront combinées pour finalement produire des informations juridiques sous forme d’observatoire.
Des entretiens avec des experts en écologie marine et halieutique sont réalisés pour identifier les règles juridiques à évaluer et des techniques d’intelligence artificielle comme le traitement automatisé des langues (NLP) sont sollicitées pour mener une analyse systématique des textes. L’utilisation d’indicateurs juridiques, outil novateur en droit de l’environnement, permet ensuite de caractériser et de quantifier le droit existant. L’intelligence artificielle sera également utilisée pour extraire et traiter les informations juridiques, afin de les comparer avec des données factuelles sur l’état des espèces et des stocks marins disponibles dans des bases de données existantes (évaluation des stocks de la FAO, bases de données UICN sur l’état de conservation…).
Ces différentes étapes permettront d’évaluer la participation du droit à la protection de la biodiversité marine dans un cadre de recherche interdisciplinaire et internationale.
A travers CO-CONSTRUCTION, BRIDGES vise à comprendre la fabrication et la mise en œuvre des normes environnementales grâce à une analyse de celles-ci à différentes échelles. Par son sujet et sa méthode, BIOMA souhaite y contribuer utilement pour une meilleure protection des écosystèmes marins de l’océan Indien, riches en biodiversité mais vulnérables aux pressions anthropiques.
Directrices de thèse : Marie Bonnin (IRD/LEMAR) et Jihad Zahir (FSS/Univ Cadi Ayyad)

Portrait
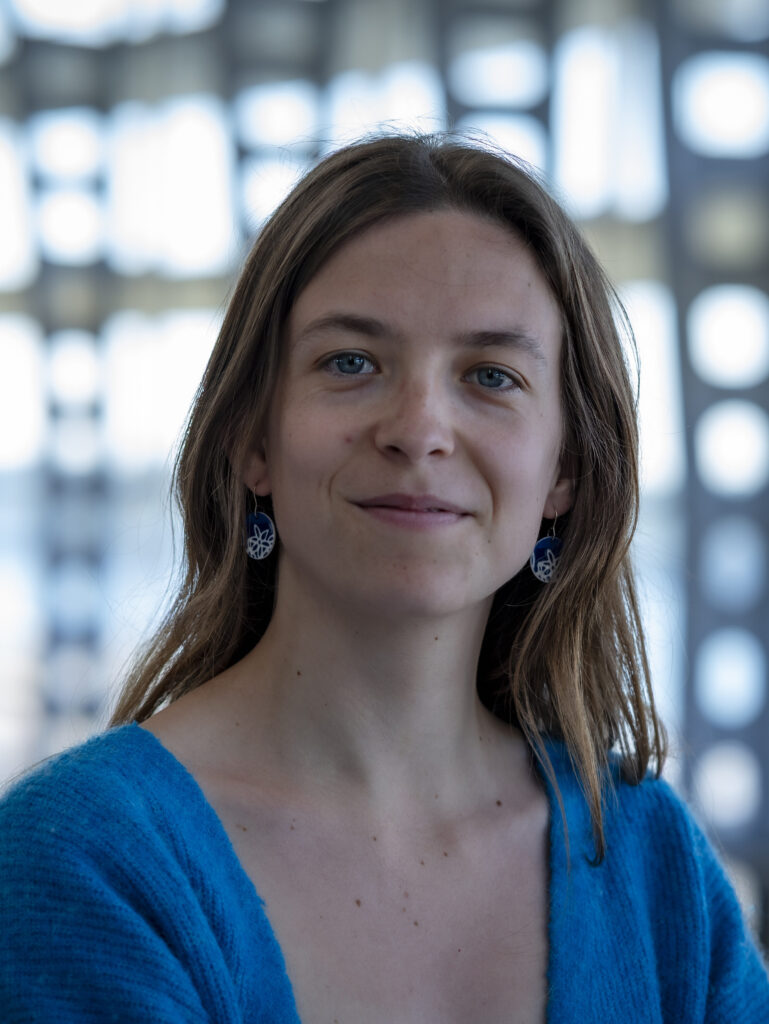
Juriste en droit de l’environnement marin, Margot Perdereau a débuté son parcours universitaire à l’Université de Caen Normandie (2019-2022), avec une spécialisation en droit public. Elle a ensuite poursuivi ses études en master Droit des espaces et des activités maritimes à l’Université de Bretagne Occidentale (2022-2024), où elle s’est passionnée pour le droit de l’environnement marin. Elle a effectué deux stages au sein du projet Nawras, à Brest (LEMAR) et à Marrakech (Université Cadi Ayyad) portant sur « où, quand et comment le droit protège-t-il les océans ? ». Avec sa thèse, elle poursuit sur ce sujet en se penchant plus particulièrement sur la protection de la biodiversité marine, notamment dans l’océan Indien.
Le droit de l’environnement, c’est quoi ?
Le droit de l’environnement désigne le droit relatif aux règles juridiques qui concernent la Nature, les pollutions et les nuisances, les sites, monuments et paysages, les ressources naturelles. Il vise à prévenir, réduire ou compenser les dommages causés aux écosystèmes. En le milieu marin, il concerne notamment la pollution, la pêche, la protection des espèces et habitats, la gouvernance des espaces maritimes, etc. Il est souvent transversal, mobilisant à la fois le droit international, régional, national et coutumier tout en se fondant sur la science.
Que sont les indicateurs juridiques ?
Les indicateurs juridiques permettent de mesurer le contenu, la mise en œuvre et les effets d’un corpus juridique. Ils traduisent des données juridiques en valeurs chiffrées, facilitant les comparaisons et l’évaluation des politiques publiques. En droit de l’environnement, ils sont particulièrement utiles pour prendre de la hauteur et identifier les lacunes normatives, les efforts de protection ou la mise en œuvre concrète de mesures de conservation.
Quels droits s’appliquent dans l’océan Indien ?
La gouvernance de l’environnement marin dans l’océan Indien repose sur une superposition complexe de normes juridiques de différentes natures et échelles. On y retrouve :
- Le droit international, notamment :
- La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, 1982), qui définit les zones maritimes (ZEE, plateau continental…), les droits des États côtiers, et les obligations en matière de protection de l’environnement marin.
- Les conventions multilatérales environnementales (CME) telles que : la Convention sur la diversité biologique (CDB, 1992), la Convention de Ramsar (zones humides, 1971), la Convention CITES (commerce des espèces menacées, 1973), la Convention de Stockholm (polluants organiques persistants, 2001).
- Le droit régional, avec : la Convention de Nairobi, les textes produits dans le cadre de la Commission de l’océan Indien (COI), notamment sur la pêche, la gestion des ressources halieutiques ou la sécurité maritime, les organisations régionales de pêche, comme la South West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC) qui émet des recommandations techniques et scientifiques.
- Les droits nationaux des États côtiers de la région.
- Les droits coutumiers ou communautaires, appliqués dans les zones rurales ou de pêche artisanale, notamment dans les LMMAs (Locally Managed Marine Areas). Ces normes peuvent régir l’accès aux ressources, les périodes de pêche ou les espèces protégées.
La Convention de Nairobi : un pilier régional
Adoptée en 1985 et entrée en vigueur en 1996, la Convention de Nairobi (ou Convention pour la protection, la gestion et le développement de l’environnement marin et côtier de la région de l’Afrique orientale) est l’unique cadre juridique régional de protection de l’environnement marin dans l’océan Indien occidental. Elle réunit dix pays : Comores, France (La Réunion, Mayotte), Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie, Afrique du Sud et Tanzanie, avec un secrétariat hébergé par le PNUE à Nairobi.
La Convention agit sur plusieurs leviers comme la conservation des écosystèmes marins, et la promotion de la coopération régionale en matière de surveillance environnementale, de planification spatiale marine et de gestion intégrée des zones côtières.
Elle agit également comme plateforme diplomatique et scientifique pour harmoniser les politiques marines dans une région marquée par de fortes inégalités juridiques et écologiques.

Le projet Nawras
Le projet Nawras, coordonné par le LEMAR et l’Université Cadi Ayyad, s’interroge sur le rôle du droit dans la protection des océans. Il développe une méthode innovante à la croisée du droit, de l’écologie marine et des data sciences. L’objectif est d’identifier les écarts entre les normes existantes et la réalité écologique, afin d’outiller les décideurs et scientifiques. BIOMA en est l’un des prolongements, appliquant ces méthodes à la biodiversité marine.
Plus d'actualités Actualités


